
 La requête devant la Cour suprême soutient qu'une restitution des droits conjugaux ordonnée par le tribunal équivalait à un « acte coercitif » de la part de l'État. (Archives express)
La requête devant la Cour suprême soutient qu'une restitution des droits conjugaux ordonnée par le tribunal équivalait à un « acte coercitif » de la part de l'État. (Archives express)
Au cours de la semaine à venir, la Cour suprême devrait commencer à entendre une nouvelle contestation de la disposition permettant la restitution des droits conjugaux en vertu des lois hindoues sur la personne. En 2019, une formation de trois juges de la Cour suprême avait accepté d'entendre les plaidoyers.
Newsletter | Cliquez pour obtenir les meilleurs explications du jour dans votre boîte de réception
Quelle est la disposition contestée ?
L'article 9 de la loi de 1955 sur le mariage hindou, qui traite de la restitution des droits conjugaux, se lit comme suit : « Lorsque le mari ou la femme s'est, sans excuse raisonnable, retiré de la société de l'autre, la partie lésée peut demander au tribunal de district, pour la restitution des droits conjugaux et le tribunal, s'il est convaincu de la véracité des déclarations faites dans une telle requête et qu'il n'y a aucun motif juridique pour lequel la demande ne devrait pas être accordée, peut décréter la restitution des droits conjugaux en conséquence. ”
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Également dans Expliqué |L'affaire Shreya Singhal qui a annulé l'article 66A de la loi informatique
Quels sont les droits conjugaux ?< /strong>
Les droits conjugaux sont des droits créés par le mariage, c'est-à-dire le droit du mari ou de la femme à la société de l'autre conjoint. La loi reconnaît ces droits, à la fois dans les lois personnelles traitant du mariage, du divorce, etc., et dans le droit pénal exigeant le paiement d'une pension alimentaire à un conjoint.
L'article 9 de la loi sur le mariage hindou reconnaît un aspect des droits conjugaux – le droit de former un consortium et le protège en permettant à un conjoint de saisir le tribunal pour faire valoir ce droit. Le concept de restitution des droits conjugaux est désormais codifié dans le droit personnel hindou, mais a des origines coloniales et a une genèse dans le droit ecclésiastique. Des dispositions similaires existent dans le droit personnel musulman ainsi que dans la loi sur le divorce de 1869, qui régit le droit de la famille chrétien.
Incidemment, en 1970, le Royaume-Uni a abrogé la loi sur la restitution des droits conjugaux.

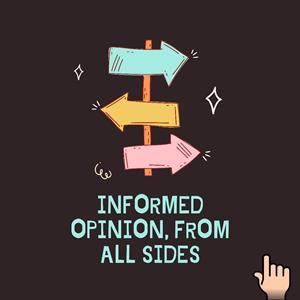
Comment peut-on introduire un recours en vertu de l'article 9 ?
Si un conjoint refuse la cohabitation, l'autre conjoint peut saisir le tribunal de la famille pour demander un jugement de cohabitation. Si l'ordonnance du tribunal n'est pas respectée, le tribunal peut saisir des biens. Cependant, la décision peut faire l'objet d'un recours devant une Haute Cour et la Cour suprême.
Normalement, lorsqu'un conjoint demande le divorce unilatéralement, l'autre conjoint demande la restitution des droits conjugaux s'il n'est pas d'accord avec le divorce. La disposition est considérée comme une intervention par le biais de la législation pour établir une note conciliante entre les conjoints d'entraînement.
Pourquoi la loi est-elle contestée ?
La loi est maintenant contestée au motif qu'elle viole le droit fondamental à la vie privée. Le plaidoyer de deux étudiants en droit soutient qu'une restitution ordonnée par le tribunal des droits conjugaux équivalait à un « acte coercitif » de la part de l'État, qui viole l'autonomie sexuelle et décisionnelle, ainsi que le droit à la vie privée et à la dignité. En 2019, une formation de neuf juges de la Cour suprême a reconnu le droit à la vie privée comme un droit fondamental.
Bien que la disposition sur la restitution des droits conjugaux ait été confirmée plus tôt par la Cour suprême, des experts juridiques ont souligné que le verdict historique de neuf juges dans l'affaire de la vie privée a ouvert la voie à des contestations potentielles de plusieurs lois telles que la criminalisation de l'homosexualité, le viol conjugal, la restitution des droits conjugaux, le test à deux doigts dans les enquêtes sur le viol.
< p>Bien que la loi soit ex-facie (« à première vue si elle ») non sexiste puisqu'elle permet à la fois à la femme et au mari de demander la restitution des droits conjugaux, la disposition affecte de manière disproportionnée les femmes. Les femmes sont souvent rappelées au domicile conjugal en vertu de cette disposition, et étant donné que le viol conjugal n'est pas un crime, les rend vulnérables à une telle cohabitation forcée.
On discutera également de la question de savoir si l'État peut avoir un intérêt si impérieux à protéger l'institution du mariage qu'il permet à une législation d'imposer la cohabitation des époux.
Explication du coronavirus
Cliquez ici pour en savoir plus
Qu'est-ce que le tribunal a dit plus tôt sur la loi ?
En 1984, la Cour suprême avait confirmé l'article 9 de la loi sur le mariage hindou dans l'affaire Saroj Rani c. Sudarshan Kumar Chadha, estimant que cette disposition « sert un objectif social en tant qu'aide à la prévention de la rupture du mariage ». Avant l'intervention de la Cour suprême, deux Hautes Cours – celles d'Andhra Pradesh et de Delhi – avaient statué différemment sur la question. Un banc de juges de la Cour suprême à juge unique, Sabyasachi Mukherjee, a réglé la loi.
En 1983, un banc à juge unique de la Haute Cour d'Andhra Pradesh avait pour la première fois annulé la disposition dans l'affaire T Sareetha contre T Venkatasubbaiah et l'avait déclarée nulle et non avenue. Le juge P Choudhary a cité le droit à la vie privée parmi d'autres raisons. Le tribunal a également estimé que dans « une affaire concernant si intimement la femme ou le mari, il vaut mieux laisser les parties seules sans ingérence de l'État ». Le tribunal avait, plus important encore, reconnu qu'une « cohabitation sexuelle » impérieuse aurait de « graves conséquences pour les femmes ».
Également dans Expliqué | Quand Tilak et Gandhi ont-ils été jugés en vertu de la loi sur la sédition ?
Cependant, la même année, une formation à juge unique de la Haute Cour de Delhi a adopté un point de vue diamétralement opposé à la loi. Dans l'affaire Harvinder Kaur contre Harmander Singh Chaudhry, la Haute Cour de Delhi a confirmé la disposition.
« D'après les définitions de la cohabitation et du consortium, il ressort que les rapports sexuels sont l'un des éléments qui composent le mariage. Mais ce n'est pas le summum bonum. Le sexe est le refrain du cas de T Sareetha. Comme si le mariage ne consistait en rien d'autre que le sexe. Chaudhary, l'accent excessif de J sur le sexe est l'erreur fondamentale de son raisonnement. Il semble suggérer que le décret de restitution n'a qu'un seul but, c'est-à-dire obliger la femme réticente à «avoir des relations sexuelles avec son mari». »
Le juge Avadh Behari Rohatgi de la Haute Cour de Delhi, tout en critiquant le jugement de la Haute Cour d'Andhra Pradesh, a ajouté qu'« il est dans l'intérêt de l'État que la vie familiale soit maintenue et que les foyers ne soient pas brisés par la dissolution de la mariage des parents. Même en l'absence d'enfants, il est dans l'intérêt de l'État que, si possible, le lien du mariage reste stable et soit maintenu”.
La Cour suprême a confirmé le point de vue de la Haute Cour de Delhi et a annulé l'Andhra Pradesh. Verdict de la Haute Cour.
- Le site Web d'Indian Express a été classé GREEN pour sa crédibilité et sa fiabilité par Newsguard, un service mondial qui évalue les sources d'information en fonction de leurs normes journalistiques.
© The Indian Express (P ) Ltd

